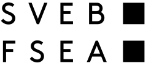En Suisse, des centaines de milliers de personnes savent à peine lire ou compter. Pourtant, le Conseil fédéral souhaite supprimer les fonds alloués à la formation continue. Dans une interview accordée au portail d’information watson, la présidente de la FSEA, Tiana Moser, explique pourquoi cela pourrait coûter cher.
Interview de Tiana Moser sur watson.ch
Le Conseil fédéral veut réaliser des économies massives dans le domaine de la formation continue, alors qu’il en avait d’abord fait une priorité stratégique. Pourquoi veut-il justement faire des économies dans ce domaine ? Est-ce la voie de la moindre résistance ?
Honnêtement, nous ne comprenons pas non plus ce revirement du Conseil fédéral. Il est contradictoire et absurde. La nécessité d’agir est évidente. Elle est d’autant plus grande en raison de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, de la pression sur l’immigration et des changements technologiques. De plus, les mesures d’économie entraîneront à long terme des coûts plus élevés, comme le montre une étude du bureau Bass.
Selon cette étude, le manque de compétences en lecture entraîne chaque année des coûts économiques de plus de 1,3 milliard de francs…
C’est pourquoi nous nous opposons de toutes nos forces aux mesures d’économie et avons notamment constitué une alliance à cette fin. Les partenaires de cette alliance sont des organisations nationales importantes telles que digitalswitzerland, la Société suisse des employés de commerce ou CARITAS Suisse.
Si nous partons du principe que la Confédération doit effectivement faire des économies, pourquoi NE PAS les faire dans le domaine de la formation continue ?
Les coûts induits seraient élevés, tant sur le plan économique que social, et dépasseraient le potentiel d’économies effectif. Cela reviendrait à démanteler une politique de formation continue urgente et efficace et empêcherait de nombreuses personnes d’avoir un meilleur avenir professionnel et personnel, ce qui nuirait également à l’économie suisse.
Combien la Confédération pourrait-elle économiser avec son programme d’économies dans le domaine de la formation continue ?
La Confédération souhaite économiser environ 19 millions de francs par an dans le domaine de la formation continue. À titre de comparaison, le manque de compétences en lecture coûte à lui seul plus de 1,3 milliard de francs par an.
Les cantons sont-ils susceptibles de combler le vide laissé par la Confédération avec son programme d’économies ?
C’est très improbable. Dans sa prise de position sur le paquet d’économies, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique a indiqué que les cantons ne compenseraient pas la suppression des fonds fédéraux. Les mesures d’économies entraîneront donc une réduction massive de l’offre de cours dans le domaine des compétences de base.
Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), 844 000 personnes en Suisse ont des difficultés à lire, à calculer et à résoudre des problèmes sans instructions directes. Selon une étude de l’OCDE, ce sont même 1,67 million de personnes qui ont des difficultés dans ces domaines. Comment expliquer ces différences entre les chiffres ?
Les publications de l’Office fédéral de la statistique et de l’OCDE se réfèrent aux mêmes données. La dernière publication de l’OFS intitulée « Vivre avec de faibles compétences en lecture, en mathématiques élémentaires et en résolution de problèmes » s’est concentrée sur les personnes qui ont des difficultés dans les trois domaines de compétences étudiés (c’est-à-dire qui atteignent au maximum le niveau 1). Le chiffre de 1,67 million se réfère aux adultes qui ont de faibles compétences dans au moins un des domaines étudiés.
Au vu de ces chiffres, il semble évident que le groupe de population concerné devrait être encouragé à suivre une formation continue. À quoi ressemblent les mesures correspondantes ?
Les offres de formation continue dans le domaine des compétences de base sont très variées. Elles vont des cours de lecture et d’écriture aux offres sur mesure pour les entreprises, en passant par des offres sans rendez-vous telles que les salons d’apprentissage, où l’apprentissage se fait de manière très informelle.
Selon l’étude de l’OCDE, la Suisse se situe certes au-dessus de la moyenne de l’OCDE, mais nettement derrière des pays comme la Finlande, la Suède, le Japon ou les Pays-Bas. À quoi cela pourrait-il être dû ?
Les causes ne sont pas claires. Cependant, les enquêtes PISA, qui s’adressent aux élèves de 15 ans, montrent des résultats similaires. Une partie de l’explication réside donc probablement dans le système scolaire, qui sélectionne très tôt les élèves. D’autres facteurs sont sans doute liés à la composition démographique de la population. En Suisse, par exemple, un nombre relativement plus élevé de personnes n’ont pas la langue du test comme langue principale. Les évaluations ont montré qu’une telle incongruité linguistique est en moyenne associée à des niveaux de compétence plus faibles.
Actuellement, le journal « Blick » tire la sonnette d’alarme avec le titre suivant : « Un enfant sur trois ne maîtrise pas correctement l’allemand ! » Cela signifie-t-il que l’immigration aggrave le problème ? L’influence de l’immigration peut-elle être isolée ?
La Suisse n’ayant participé qu’une seule fois aux enquêtes PIAAC, de tels effets ne peuvent être prouvés. Les données d’autres pays montrent toutefois que l’immigration n’a qu’un impact limité sur les compétences linguistiques moyennes. L’évolution des compétences des immigrants dépend quant à elle de deux facteurs principaux : le profil des migrants et les institutions et mesures politiques qui favorisent leur intégration.
Le taux de participation aux offres de formation continue est faible. Pourquoi ?
Les raisons sont très diverses. Outre des raisons objectives telles que le manque de temps ou d’argent, il existe également de nombreuses raisons subjectives telles que des expériences négatives dans le milieu scolaire, l’intériorisation de l’idée d’être déficient ou encore une certaine résistance aux attentes normatives. La FSEA a examiné ces raisons dans une étude et a constaté que les décisions de ne pas suivre de formation continue sont tout à fait sensées et compréhensibles du point de vue des personnes concernées. Elles ont développé des stratégies qui leur permettent de bien gérer leur quotidien malgré des compétences de base limitées. Dans des situations de vie précaires, la participation à une formation peut également représenter une charge supplémentaire importante. En raison d’expériences négatives à l’école ou d’une faible confiance en leurs propres capacités d’apprentissage, la participation à une formation peut même parfois être perçue comme une menace.
Comment pourrait-on augmenter le taux de participation ?
L’augmentation du taux de participation est l’une des tâches principales des organisations de formation continue telles que la FSEA. Il est donc d’autant plus incompréhensible que ce soient précisément ces fonds qui soient supprimés. Ces dernières années, les prestataires de formation continue et les structures de soutien ont déployé des efforts considérables pour adapter leur offre à la réalité de la vie et aux besoins des participants potentiels. Cependant, pour toucher le plus grand nombre de personnes possible, il faut une offre encore plus diversifiée, un accès plus facile et davantage de formations présentant un intérêt pratique pour la vie quotidienne. Il est également essentiel de sensibiliser le public à ce sujet et de le détabouiser.
Existe-t-il des études qui quantifient le succès des mesures mises en œuvre jusqu’à présent pour promouvoir la formation continue ?
Une étude récemment publiée par le Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation a montré que la formation professionnelle continue en Suisse a des effets positifs sur les revenus et réduit le risque de chômage. Dans le domaine des compétences de base, les rapports des participants aux cours dans le cadre de la campagne «Simplement mieux !… au travail» soutenue par la Confédération illustrent bien les effets des cours : par exemple, un chauffeur de bus qui comprend enfin mieux ses passagers ou un employé semi-qualifié qui, grâce à l’amélioration de ses compétences en lecture, peut désormais obtenir un certificat de capacité.