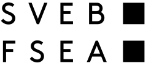L’étude «Points de vue subjectifs concernant les compétences de base: motifs de non-participation aux offres de formation» de la FSEA a cherché à comprendre, à l’aide d’entretiens qualitatifs, pourquoi les personnes ayant de faibles compétences de base ne suivent pas de formation continue dans ce domaine. Helen Buchs, responsable du projet, explique comment interpréter les résultats et comment le secteur de la formation continue pourrait y réagir.
Quel était le point de départ de l’étude? Ou plutôt: que savait-on déjà?
On savait qu’en Suisse, près d’un tiers des adultes ont des difficultés avec les compétences de base. Ces personnes participent moins souvent aux offres de formation continue que celles qui ont un niveau de compétences plus élevé. On savait également certaines choses sur les raisons de cette non-participation généralisée. À savoir que des obstacles tels que le manque de temps, les problèmes de santé ou les faibles ressources financières jouent un rôle important. De plus, la recherche et la pratique avaient montré que les raisons subjectives, basées sur les expériences et les interprétations des personnes concernées, sont au moins aussi importantes.
Quelles sont les nouvelles conclusions de l’étude?
L’étude fournit désormais un aperçu plus approfondi des raisons subjectives de la non-participation. Elle montre que les décisions de ne pas suivre de formation continue sont compréhensibles du point de vue des personnes concernées. Elles ont développé des stratégies d’adaptation efficaces qui leur permettent de gérer leur quotidien malgré leurs faibles compétences de base. Beaucoup évitent délibérément les contextes d’apprentissage structurés, car elles ont eu des expériences négatives dans leur parcours éducatif. Souvent, elles ont également intériorisé des attributions de déficits qui affaiblissent la confiance en leur propre capacité d’apprentissage. La nouveauté réside notamment dans la constatation que les attentes sociales influencent les raisons subjectives invoquées pour ne pas participer. Les personnes concernées ont clairement conscience qu’il existe une norme socialement reconnue quant à la manière dont on devrait savoir lire, écrire ou compter. Beaucoup trouvent cette pression pesante, parfois évidente mais souvent subtile, qui les pousse à s’adapter à cette «littératie dominante». La non-participation à la formation continue n’est donc pas seulement un «désintérêt», mais souvent aussi une résistance à ces exigences normatives.
Quelles conclusions en tirer?
Les résultats mettent en évidence une zone de tensions: d’une part, de nombreuses personnes concernées souhaitent améliorer leur situation et sont prêtes à faire des efforts pour améliorer leurs compétences de base. D’autre part, elles perçoivent les attentes sociales en matière de compétences de base comme une pression ou une stigmatisation auxquelles elles ne veulent pas s’exposer davantage en participant à une offre de formation; ceci d’autant plus que leur quotidien fonctionne aussi sans cela et que les formats de formation classiques sont souvent associés à des expériences négatives. On peut en conclure qu’il ne s’agit pas seulement d’aider les personnes concernées à améliorer leurs compétences de base. La manière dont cela peut être réalisé est également déterminante. Il convient également de remettre en question les offres, les logiques de soutien et les normes sociales.
Comment le domaine de la formation continue doit-il réagir à cela?
Le domaine de la formation continue peut contribuer à ce que l’apprentissage ne soit pas associé à une pression d’adaptation. Les objectifs éducatifs abstraits ne sont guère motivants. Les offres de formation doivent être conçues de manière à être subjectivement perçues comme utiles, accessibles et gratifiantes. Il faut donc des offres adaptées au monde réel. Il faut également un éventail d’offres diversifié qui reflète l’hétérogénéité du groupe cible.
Concrètement, qu’est-ce que cela signifie d’adapter les offres au quotidien des participantes et des participants potentiels?
S’adapter au quotidien signifie concevoir des offres qui ne soient pas abstraites, mais qui répondent à des problèmes réels du quotidien et à des besoins concrets. Cela peut signifier, par exemple, que les outils numériques, les obligations familiales ou les défis de la vie professionnelle soient spécifiquement abordés comme des occasions d’apprentissage. Les offres de formation continue devraient délibérément utiliser un langage qui ne soit pas déficitaire, reconnaître le potentiel existant et se concentrer sur la pertinence subjective. L’accessibilité doit être améliorée grâce à des accès faciles et à un développement participatif des offres. En outre, des points de contact neutres, des possibilités d’apprentissage informelles et des formats flexibles peuvent permettre de jeter des ponts.
Dans quelle mesure la société est-elle également mise au défi?
L’étude montre clairement que la conception sociale de ce qu’est la «littératie légitime» a un effet d’exclusion. Elle crée une image de «déficit» à laquelle beaucoup ne peuvent ou ne veulent pas se conformer. Un changement de perspective est donc nécessaire au niveau social: les compétences de base doivent être comprises non seulement d’un point de vue fonctionnel, mais aussi biographique et contextuel. Il est nécessaire de réfléchir à qui est exclu par certaines attentes.